« Tu es bien gentil avec ton veganisme mais la carotte, elle souffre aussi non ? Regarde un peu tout ce que l’on sait sur la communication chez les arbres par exemple. »
Voici en résumé l’argument massue qui pourrait laisser votre adversaire/ami végétarien sur le bas-côté épistémologique. On connaît le fameux triptyque du vegan : bon pour la santé, bon pour l’environnement et bon pour l’éthique. J’y vais un peu au feeling mais pour moi ces 3 arguments sont indéniables. N’étant pas intégralement végétarien, mais étant de ce côté par simple raisonnement logique, par honnêteté intellectuelle, je suis justement attentif à tout argument consolidant l’édifice philosophique du vegan.
Et donc il y a cette question complexe de la souffrance dans le monde végétal. Aussi quand un ami militant m’a soumis l’interview de Florence Burgat, chercheuse à l’INRA, et qui parle exactement du sujet avec un essai à la clé, j’ai accouru voir de quoi il retourne. Elle est philosophe – doctorat sous la direction de Jean-Claude Beaune ce qui mériterait une digression anecdotique et personnelle…
Bon on va aller vite… les 30 minutes d’interview sont un échec. Chaque concept qu’elle invoque sont autant de tentatives avortées pour convaincre le lecteur ouvert que je suis, pourtant désireux d’être convaincu. Systématiquement, elle est victime de son postulat à savoir qu’il existe une coupure entre le monde animal et le végétal. Et donc des « caractères » chez les animaux sont « coupés » quand on veut les transposer dans le monde végétal. Je vais même aller plus loin… c’est de la très mauvaise philosophie. Peut-être s’est-elle autant fourvoyée en raison des motivations qu’elle avoue : à savoir régler ses comptes aux ouvrages à succès à propos de l’intelligence des plantes, en premier lieu le livre du forestier allemand Peter Wohlleben « La vie secrète des arbres ». Rappelons que ce best-seller botanique synthétise pas mal de découvertes scientifiques sur la « communication » entre les arbres et qu’il verse dans l’anthropomorphisme : jalousie, entraide, souci des seniors… etc.
Cette question de l’anthropomorphisme est d’ailleurs fondamentale, nous verrons pourquoi.
Mais examinons d’abord les différents concepts avancés par la philosophe :
Le soi – l’ipséité
La plante aurait une « immortalité potentielle », elle n’a pas réellement de naissance ni de mort. On se moque gentiment du talentueux jardinier Gilles Clément qui insiste pourtant à juste titre sur sa profession qui est hélas traditionnellement une activité où l’on est « masqué et casqué pour tuer ».
« Mais non ! rétorque la philosophe, il suffit de voir qu’en désherbant, cela finit toujours par repousser ». Argumentation consternante. Comme si l’on massacrait les fourmis chez soi en se désolant que l’on ne s’en débarrasse finalement jamais.
Mais d’une manière générale, on ne comprend pas pourquoi le végétal n’existerait pas en tant qu’individu. Elle parle des graines « comme mortes », des pantes qui repoussent (boutures ?) afin de montrer que le monde végétal est plus une histoire de cycle que de point. Pour le règne végétal, seul compterait la vue d’ensemble, pas la perception individualiste.
C’est tentant mais fallacieux. Un charme que l’on tronçonne, ce n’est plus un charme. Il est mort. Oui le règne végétal donne à voir des choses bizarres où la notion de « colonie » est plus importante que la notion d’individu. Et alors ?
La non-présence au monde – la conscience
Deuxième tentative avec l’argument plus naïf. La preuve, quand j’ai posé la question à mon enfant de 10 ans, il m’a répondu : « une plante ne souffre pas car elle n’a pas de nerfs ».
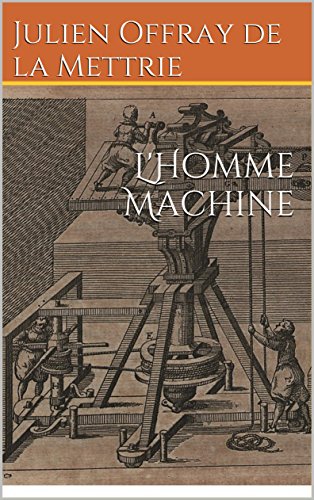
Pour Florence Burgat, la plante n’est pas dans le « vivre » mais dans la « vie » (H. Jonas). Elles n’ont pas de monde intérieur (intentions, désirs…) mais réagissent seulement à l’extérieur (stimuli, réflexes). Se rend-elle compte qu’elle utilise le même registre que La Mettrie et Descartes qui voyaient dans l’animal une sorte de machine ? C’est vraiment l’arroseur arrosé.
Mais faisons amende honorable puisqu’elle touche aussi du doigt quelque chose de plus subtil : la radicale altérité. Concept qu’elle emprunte au brillant Francis Hallé et que l’on peut résumer ainsi : « moi humain, je suis désemparé face au végétal car je ne peux pas pénétrer son monde ». Hélas, cette notion d’altérité a aussi été popularisée par le philosophe Thomas Nagel avec son célèbre « Quel effet ça fait d’être une chauve-souris » qui reprend en fait la vieille notion de Qualia. Et même de solipsisme s’il faut à notre tour évoquer Schopenhauer.
Bref, par définition les plantes sont très différentes des animaux. C’est pour cela qu’on les met dans deux « Règnes » différents. Nos royaumes se côtoient mais ne se comprendront jamais. Au fond c’est la question de savoir s’il s’agit de différences de degré ou de différences de nature. Et là on est mal barré car ce genre de question est le meilleur moyen de développer ses talents de sophistes.
Personnellement je suis enclin à voir entre un champignon et un moustique une différence de nature. Mais entre un crapaud et une grenouille ? Entre un corail et une algue ? Entre une anémone et un pissenlit ? Nous sommes forcément prisonniers de nos taxonomies, de nos conventions. Nous disons que toutes ces choses sont « vivantes ». Mais nous ne savons pas ranger le virus ou le prion.
Si le protecteur de la carotte se joue du végétarien, c’est bien qu’il fait appel à la notion de « vivant ». Tout l’enjeu, rappelons-le, est de montrer si en coupant règne végétal et règne animal, on a au passage coupé quelque chose appelé « sentiment ». Le piège linguistique est d’autant plus gris que « anima » est l’étymologie de l’âme. Et donc notre vocable nous conditionne déjà à refuser une âme à l’endive, mais d’en accorder une à la méduse.
Autotrophe !
Alors revenons à ce qui différencie fondamentalement ces deux règnes. Florence Burgat nous rappelle que la plante est autotrophe (elle se suffit… juste un peu d’eau et de lumière) alors que l’animal est hétérotrophe (il dépend directement ou indirectement des autotrophes). Nuance est apportée (forcément, dans la nature rien n’est aussi binaire) avec les dépendances fleurs/pollenisateurs. La philosophe y voit une « surpuissance » qui à mon avis à toujours à voir avec cette histoire d’indifférence au monde.
En gros, si vous approchez d’un animal il va certainement s’enfuir. Si vous approchez d’un arbre , que vous lui donner un coup de pied… peu lui chaut.
En fait, dans le discours de cette philosophe, l’immortalité et la surpuissance sont comme des éléments divins qui mettent « hors monde » nos amis végétaux. Le règne végétal, c’est l’Olympe. Est-ce que Zeus peut souffrir à cause d’un simple mortel ?
Cette intuition inconsciente semble se confirmer car si Florence Burgat est assurément du côté de la défense du vivant, et donc des végétaux, elle ne leur accorde au fond qu’une valeur esthétique, historique…
Mais elle pouffe quand il s’agit de faire reconnaître juridiquement un olivier ou un hêtre remarquable. Rappelons que ce débat sur la reconnaissance juridique des non-humains pourrait pourtant n’être qu’une extension du domaine de la lutte. Il n’est pas plus absurde de reconnaître des droits à un mouton qu’à un if.
Je m’aperçois que je suis long. Je synthétise donc :
- Le règne végétal est distinct du règne animal mais cette distinction repose sur un critère (autotrophie) qui n’a rien à voir avec les affects
- Le même raisonnement qui permet de reconnaître la souffrance animale (i.e. anthropomorphisme) peut tout à fait s’étendre à la « souffrance » végétale.
- La philosophe Florence Burgat refuse cette extension en décrétant tautologiquement que les végétaux n’ont pas de sentiments.
- Nous sommes piégés par le langage qui par exemple n’a rien pour désigner l’ « intelligence sans cerveau ».
Je me permets une audace personnelle sans filet.
Quiconque a déjà caressé des sensitives (mimosa pudica) a eu le sentiment que leur thigmonastie relevait d’un être réellement sensible.
Quiconque a déjà caressé un corail a eu le sentiment du vide minéral. Anima signife âme mais signifie « mouvement ». Ce qui bouge tout seul nous semble vraiment vivant.
Mieux, ce qui a des yeux nous semble doué de souffrance. Même l’œil vitreux d’un maquereau agonisant appelle à la compassion. Les gendarmes (punaise de feu) me semblent bizarrement plus fraternels que le tipule pourtant appelé cousin. Juste parce qu’il porte des « yeux » sur son dos. C’est ainsi. Je suis bête comme un humain qui anthropomorphise et qui considère que les yeux sont le reflet de l’âme.

L’arbre ne bouge pas, il n’a pas d’oeil. Il est dans son monde en effet. Mais ce n’est pas parce que ce monde est radicalement différent que je doive y calquer mes notions purement propres aux hominidés.
Je trouve tellement surprenant d’invoquer Levi-Strauss qui pour moi fut une révélation dans ce long chemin d’altérité que je me demande sincèrement si cette philosophe a lu les mêmes choses que moi. Mais après tout, c’est ce qui fait richesse. Il reste des différences de degré avec les personnes et les réflexions dont je me sens pourtant proche.
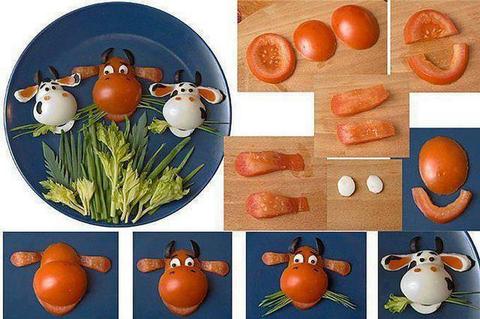
La plante est autotrophe alors que l’animal est autotrophe. Il y en a forcément un qui ne l’est pas. Coquille ?
C’est corrigé. Merci 😉
Merci